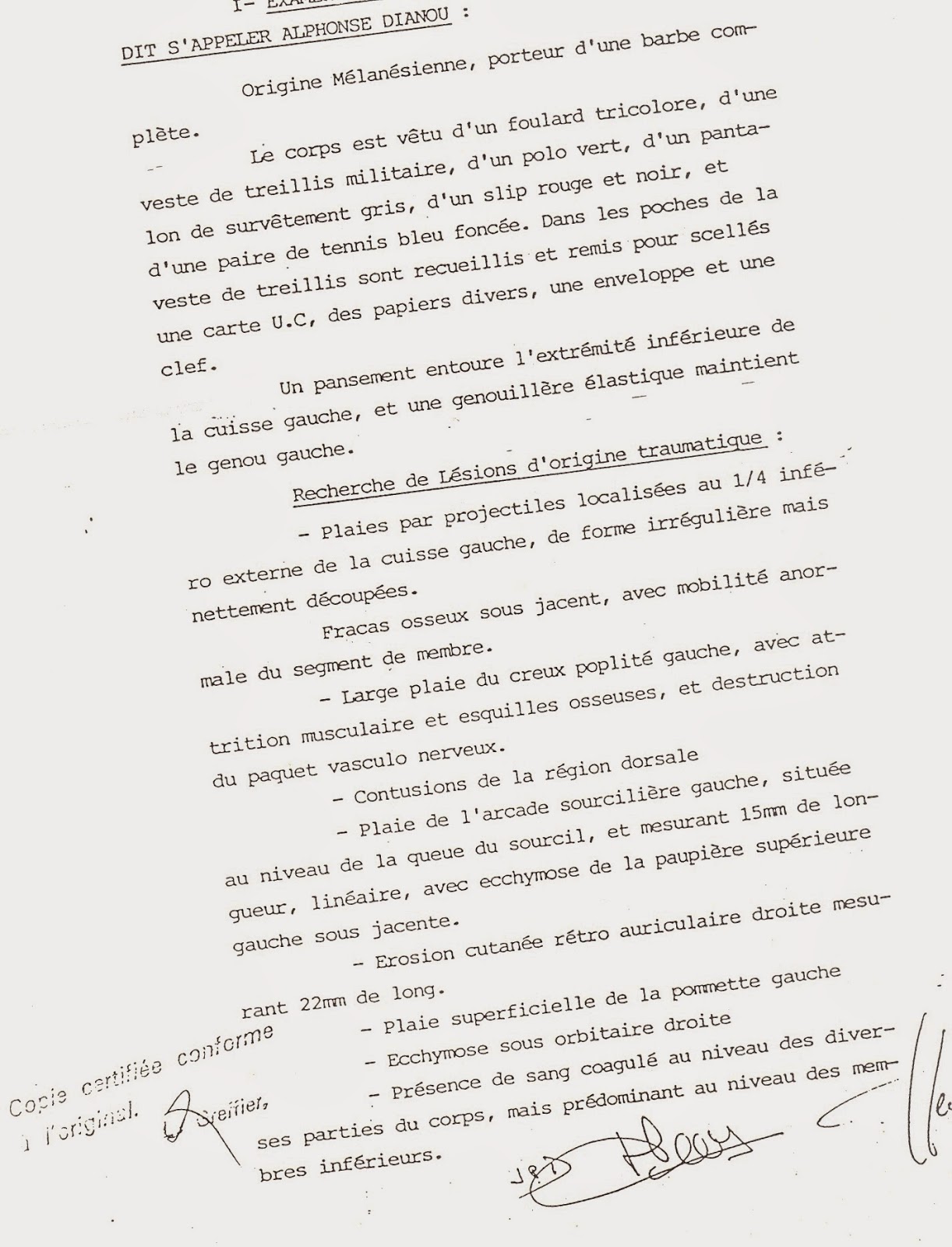Contre-enquête sur des
morts suspectes
4.Exécutions sommaires:des militaires témoignent
«On
avait la haine du Kanak!»
Plusieurs de mes interlocuteurs se sont réfugiés derrière cette
formule, comme si l'aveu valait absolution des excès commis avant,
pendant et après l'«Opération Victor» ou, à tout le moins, comme
s'il avait le pouvoir d'atténuer leur propre responsabilité.
Ajoutées aux préjugés et parfois aux souvenirs mitigés d'un
précédent séjour agité en Nouvelle-Calédonie, les accusations
outrées de Jacques Chirac dénonçant «la
sauvagerie», «la
barbarie» dont auraient
fait preuve les meurtriers des quatre gendarmes de Fayaoué ont
produit un
cocktail délétère, fait de mépris et de ressentiment.
Et elles ont provoqué chez certains de ceux qui ont «servi» durant
ces événements le désir malsain de faire payer aux Kanak les
crimes perpétrés au matin du 22 avril. Un désir qui, pour
quelques-uns, trouvera son aboutissement le 5 mai dans le nord
d'Ouvéa.
Pas de quartier pour les preneurs d'otages! Avec ou sans mot
d'ordre et en dépit des consignes «officielles», telle est la
ligne de conduite qui semble s'être imposée lors de la première
phase de combat. Le bilan ne mentionne pas le moindre blessé parmi
les indépendantistes. Et pas un seul Kanak n'a été fait
prisonnier.
Pour
conquérir la cuvette, les hommes du 11ème Choc ont progressé
derrière «un mur de
feu». Des tirs en rafales, ininterrompus, qui peuvent certes
expliquer les blessures multiples relevées par les légistes et
même, pourquoi pas, la présence d'une plaie à la tempe ou entre
les deux yeux. Mais sûrement pas l'addition de projectiles tirés de
face et d'une balle dans la nuque ou derrière le pavillon de
l'oreille! Ou inversement, d'une rafale dans le dos et d'un
projectile en plein front. «Il fallait être à moins de dix
mètres pour avoir une chance d'apercevoir un ennemi, et encore!»,
témoigne Pierre Oléron, l'officier en second du commando Hubert.1 Difficile dans ces conditions de faire preuve d'une grande précision.
Silence dans les rangs du 11ème Choc
Alors
quoi? Fidèles au serment prêté lors de leur admission au 11ème
Choc, le régiment de la DGSE, les «anciens» d'Ouvéa ne livrent pas leurs souvenirs sur les
réseaux sociaux et, d'une manière générale, ne revendiquent pas
leur appartenance présente ou passée à une unité qui a longtemps
senti le soufre. Je n'ai donc pas trouvé de témoin dans leurs rangs.
«Chez ces gens-là, on ne cause pas,
Monsieur! On ne cause
pas.» Jean-Jacques Doucet, qui commandait l'ensemble du dispositif, a
bien voulu évoquer «le contexte», mais pas l'opération elle-même.
L'ex-capitaine Bruno de Seyssan de Marignan m'a invité à lui
transmettre mes questions par courriel mais ne m'en a pas même
accusé réception. Quant à son pendant,
Maurice Grognier, devenu consultant dans une société internationale
de sécurité et de protection, il est demeuré introuvable.
Résultat : d'autres se chargent de parler à leur place. D'expliquer
le pourquoi de tous ces morts et
l'impression de mise en scène qui se dégage des observations faites
par les OPJ.
Les
anciens gendarmes d'élite, eux, ne sont pas avares d'explications.
«On ne peut pas
laisser un ennemi derrière soi sans vérifier s'il est vivant ou
mort. Alors, on commence par écarter son arme et puis on le
retourne.»
L'ex-otage Bernard Meunier, ancien négociateur du GIGN, se fait
volontiers pédagogue. Mais certains de ses camarades énoncent de
manière plus explicite ou plus abrupte ce qui leur apparaît comme
une évidence. «Pour
la plupart, c'était leur baptême du feu et les
petits jeunes du 11ème n'ont pas fait le détail.»
«Ils ont
appliqué les règles qu'on leur avait enseignées : quand on
veut réduire une poche de résistance isolée, on
ne laisse pas derrière soi un homme susceptible de vous tirer dans
le dos. On
écarte l'arme et on fait en sorte qu'il ne puisse pas s'en
resservir...»
Ou encore :«Les “nettoyeurs”du
11ème Choc sont passés par là...»
Tué à l'arme blanche ?
Onze
des treize tués du premier assaut ont reçu une balle dans la
tête. Mais, dans son rapport, la Ligue des Droits de l'Homme a aussi
évoqué la possibilité que
certaines des blessures constatées aient été occasionnées par des
armes blanches. Une hypothèse également formulée par des parents
lors de l'ouverture des cercueils pour identification, quatre jours
après la bataille, renforcée par le fait que les légistes n'aient pas
toujours spécifié la cause de ces blessures. Dans le doute, difficile de
formuler un avis. Reste que dans un cas au moins, celui de Nicolas
Nine, elle semble être justifiée. L'une des dix plaies et impacts
retrouvés sur son corps est «une
large plaie de forme trapézoïdale
mesurant 11cm dans son plus grand axe et 4cm dans son plus petit»,
aux «bords
déchiquetés et entourée d'un large halo ecchymotique»
qui ne peut pas être attribuée à un projectile par arme à feu. Et
le halo évoqué par les médecins s'observe fréquemment après un
coup violent porté à l'arme blanche, lame enfoncée jusqu'à la
garde.
Le
mort
n° 18 enfin, Martin Haïwé, dont le corps sera retrouvé en
dernier, présente une seule blessure, mortelle, dans le bas du dos, mais
rien dans le compte-rendu des légistes ne permet de déterminer
si elle a été provoquée par un projectile ou par une arme blanche.
Les médecins, qui n'en ont pas indiqué les dimensions, signalent par
ailleurs l'existence d'une plaie
superficielle à l'arcade sourcilière droite et précisent que«les
paupières droites sont tuméfiées». Martin
Haïwé, rappelons-le, était désarmé.
On a voulu tromper les OPJ
Voilà
pour l'absence de blessés et de prisonniers. Et maintenant, quid
de la scène de combat?Là encore en dépit des consignes, des corps
ont été regroupés, des armes déplacées. Consultant en matière
de sécurité, expert en balistique auprès des tribunaux, Alério
Nannini était lieutenant à l'EPIGN dans le groupe du capitaine
Pattin. «En police judiciaire, on
«gèle» la scène de crime mais dans
un schéma de guerre, on ne peut pas maintenir les choses en l'état,
explique-t-il.
Les armes doivent être mises hors de portée.» Cela
peut se comprendre. Accueillis
par des gendarmes du
GIGN, l'adjudant Da Silva et son équipe constatent en effet «des
modifications apportées volontairement par des tiers». «Des
armes, chargeurs et munitions ont été retirés des lieux au cours
de l'opération pour être placées en sécurité en haut du cratère,
près du poste de guet S. Néanmoins, ajoute Lionel Da Silva, il n'a pas été possible d'identifier
les membres du commando qui ont rapporté ces armes.»
Au
poste S les OPJ ont donc retrouvé quatre P. A MAC 50, un FRF2,
un MAS 36 et deux fusils de chasse. Ainsi que des cartouches et six
chargeurs dont aucun correspondant aux MAC 50. Huit armes qui
viennent s'ajouter à celles retrouvées au fond de la cuvette et
dans les postes environnants. En apparence, le compte est bon :
sur le papier, cela fait largement autant d'armes que de combattants,
et l'on peut en déduire que tous avaient bien une arme à la main.
Balayée,
la version kanak des victimes désarmées? Non. D'abord parce que les quatre chargeurs de P.A
manquants n'ont été retrouvés nulle part. Ni aux postes de combat
ni sur les Kanak eux-mêmes, qui presque tous avaient des munitions
dans leurs poches. Ensuite, parce que le FRF2, un fusil de haute
précision, appartenait à l'un des hommes de Philippe Legorjus
contraints de se constituer prisonniers mais qui avaient
préalablement rendu leurs armes inutilisables : visée faussée
et percuteur retiré. Dès lors, une partie des armes «déplacées»
ne pouvaient pas avoir servi. Le compte n'y est plus. Et il y a bien
eu tromperie!
Une si longue absence
Cette
mise en scène a-t-elle eu lieu juste avant l'arrivée des OPJ ?
A-t-on mis à profit les longues heures écoulées entre le
cessez-le-feu matinal et le second assaut, lancé à seulement 12h30?
Un intermède employé à mettre sur pied un nouveau plan d'attaque
et, selon le général Vidal, à récupérer à Saint-Joseph des
grenades offensives et les masques panoramiques du commando Hubert.2 Une pause dont le général justifie la prolongation par l'absence de
Philippe Legorjus, le mieux à même selon lui de mener une ultime
négociation. Ce dernier aurait fait
valoir qu'il devait au préalable troquer son uniforme contre des
vêtements civils «pour ne pas montrer à Dianou qu'il avait
participé au premier assaut». Le commandant du GIGN, qui en
réalité n'a fait que diriger ses hommes depuis un abri rocheux, a
donc rejoint Saint-Joseph où des habitants l'on croisé alors qu'il
sortait de la douche, puis se serait rendu à Fayaoué, de son propre
chef, pour tenter une dernière démarche auprès du Bureau politique
du FLNKS et de Franck Wahuzue, l'un des organisateurs de l'attaque de
la gendarmerie, que Dianou lui avait désigné pour interlocuteur. A
12h10, Legorjus est de retour, vêtu d'un short
et d'un polo, en compagnie du capitaine de vaisseau Laurent Jayot. Après un
passage-éclair à l'antenne chirurgicale où le Dr Guillotreau a
tout juste eu le temps de l'examiner, le commandant des
fusiliers-marins a repris le chemin des combats. Et c'est lui qui se
substituera au capitaine Legorjus pour adresser en vain à Dianou un
dernier appel à la raison.
Achevé d'une rafale de «HK»
Pas un seul coup de feu n'a été entendu entre les deux assauts. C'est
pourtant dans cet intervalle, dans cette phase d'apaisement, qu'a eu
lieu la première indiscutable «bavure» : le meurtre de Samuel
Wamo, la victime ignorée de la justice civile, passée par profits
et pertes dans le rapport d'enquête militaire.
Peu
de temps après le cessez-le-feu obtenu à grand-peine, l'un des
gendarmes mobiles détenus en otages, l'adjudant-chef Jean Coquet, a
proposé à Dianou et obtenu des militaires l'autorisation d'évacuer
ce jeune Kanak, blessé par ricochet d'une balle dans le thorax. «Il
semblait gravement touché et était incapable de se bouger seul.
Nous l'avons amené à une trentaine de mètres de la grotte et
sommes revenus vers nos geôliers. Le blessé a été évacué par
deux soldats que j'ai pu apercevoir», expliquera le «mobile»
Alberto Addari, de Villeneuve-d'Ascq, qui a transporté le blessé
avec l'aide d'un collègue de l'escadron d'Antibes, surnommé «Miam».
Ce
sont deux hommes du groupe des «jalonneurs» de l'EPIGN qui vont se
charger de «réceptionner» Samuel Wamo et de le déposer à l'abri
un peu plus loin sous des cocotiers. Compte tenu de son état, il
aurait dû être rapidement brancardé jusqu'à la DZ par des soldats
du RIMaP. Mais il n'ira pas plus loin. Il y a là un officier du
commando Hubert, armé d'un pistolet-mitrailleur Heckler und Koch MP3 avec silencieux intégré. Le «HK» est une arme que
peu d'unités reçoivent en dotation. L'un des deux gendarmes
parachutistes, le maréchal-des-logis-chef H.... demande à
l'officier s'il peut le lui passer pour qu'il l'examine de plus près,
puis s'il peut l'essayer. Il dirige l'arme vers le blessé et tire. En
rafale.
Trois
balles dans le bras droit. Deux au niveau du mamelon droit.
Une qui a pénétré à trois centimètres sous le pavillon de
l'oreille droite. Lors de son autopsie, le corps de Samuel Wamo présentera six impacts
en plus de sa première blessure. Sa mort est passée presque inaperçue : grâce au
silencieux, on n'entend pas un tir de «HK» à une distance de plus
de 5 mètres...
Dans
le rapport d'enquête remis le 30 mai à Jean-Pierre Chevènement, le
nouveau ministre de la Défense, le cas de Samuel Wamo - dont le nom
n'est pas même mentionné - sera réglé en cinq lignes. Les
inspecteurs généraux y évoquent son évacuation et concluent en
une phrase : «Il est pratiquement établi que la gravité des
blessures (poumon et abdomen) a entraîné la mort assez rapidement».
Affaire classée! Son meurtrier ne sera jamais inquiété. Son geste
restera ignoré, y compris au sein de sa propre unité. Et en 1995,
il sera décoré de la Médaille militaire...
Le deuxième assaut n'a fait qu'un mort
A
l'extérieur de la grotte, Alberto Addari est assis le dos tourné à
la cuvette, faisant office de bouclier humain et masquant en partie
un Kanak dans lequel Philippe Legorjus a cru reconnaître Alphonse
Dianou. Deux tireurs d'élite du commando Hubert ont pris position
côte à côte sur la crête, l’œil rivé à la lunette de leur
7,62 long. Un FRF2, d'une portée de 800 mètres. Entouré des chefs
d'unité, Jacques Vidal s'interroge sur la conduite à tenir. Dianou
éliminé, les indépendantistes seraient sans doute plus disposés à
se rendre. Les fusiliers-marins l'ont dans leur ligne de mire. C'est
l'occasion ou jamais. «Le général se tourne vers Legorjus qui,
deux doigts tendus appliqués contre la
tempe, imite le geste de celui qui appuie sur la
détente», raconte l'un des officiers présents. Le général
ordonne alors un tir simultané. Une balle fait éclater la tête de
Vincent «Las» Daoumé que l'on a confondu avec son chef, et une
deuxième transperce la jambe droite d'Alberto Addari.
Les
actions s'enchaînent. Le lance-flammes projette une boule de feu au
pied de la grotte pour faire refluer ses occupants. Le capitaine
Grognier, du 11ème Choc, qui s'est porté volontaire, «a foncé
bille en tête» se souvient le Dr Thomas, le médecin de
l'unité. Avec quatre de ses hommes constitués en binômes qui ont
pris position de part et d'autre de la grotte et «balancé» à
l'intérieur deux chapelets de grenades offensives récoltées auprès
de tous ceux qui en disposaient encore. Une
offensive éclair suivie d'un dégagement immédiat et de
l'entrée en scène du GIGN.
C'est
«le Gros Michel», le maréchal-des-logis-chef Michel Lefèvre, qui
a été désigné pour investir la grotte. Il est accompagné de huit
de «ses gars» reliés deux par deux au moyen
de cordelettes et protégés par des casques à visière
panoramique. Après avoir pris pied sur le premier palier, les hommes
de tête expédient deux grenades lacrymogènes dont l'une va dévaler
au fond de la grotte et décider Jean-Pierre Picon et Patrick
Destremau à quitter la cavité où est réfugiée la quasi-totalité
des otages, pour s'engager dans la cheminée qui mène vers la
surface. Il n'y aura pas de tirs et pas de
riposte. Vincent Daoumé seul a été tué au cours de cette
phase très brève. Michel Lefèvre me l'a confirmé, de même que
Jean-Jacques Marlière, celui de ses hommes avec lequel il a découvert deux
Kanak dissimulés dans une faille et qui se rendront sans
difficulté : Martial Laouniou et David Adjougniope.
Le
groupe Lefèvre ne s'aventurera pas plus avant dans la grotte et de
retour au grand jour, «le Gros Michel» se servira
de Martial Laouniou («en
me pointant une arme
sur la tête», dira
celui-ci) pour tenter de convaincre Dianou de se rendre. Sans succès.
«Le GIGN lance à nouveau des grenades lacrymogènes. Il y a un
échange de coups de feu à l'entrée de la grotte. C'est
là que Lavelloi est tué et Dianou blessé»: dans son livre publié en 2010 Jacques Vidal persiste et signe. D'une
seule phrase, il couvre deux «bavures» d'un coup. Deux
vraies grosses «bavures» qui ont fait couler beaucoup
d'encre.
Un «coup de 12» a «étendu» Alphonse Dianou!
Après
ces nouveaux jets de grenades, l'air est devenu irrespirable à
l'intérieur de la grotte enfumée et Alphonse Dianou finit par
accéder à la demande pressante de Joseph Tangopi, le «coutumier»,
de préserver la vie de ses compagnons et des porteurs de thé.
Dianou accepte de déposer les armes et de se rendre. Il est le
premier à quitter la grotte sacrée, suivi de Wenceslas Lavelloi et
avec à la main la massue de cérémonie sculptée, symbole de
pouvoir, au manche orné de fils de coton aux couleurs du drapeau
kanak et prolongé d'un chiffon rouge, dont il refuse de se séparer.
Selon
les récits des rescapés, «Alphonse
s'était rendu et était allongé sur les cailloux» à
l'extérieur de la grotte lorsqu'un «militaire» lui a tiré
derrière le genou. Cette version sera confirmée par un témoignage
anonyme rapporté le 28 mai par Le Monde, celui d'un officier
qui aurait livré le nom du tireur aux généraux enquêteurs :
Alain Pustelnik, un membre du GIGN.
Responsable
de la sécurité au sein d'un groupe de grande distribution,
l'ancien supergendarme aux multiples faits d'armes3, décoré de
la Légion d'honneur par François Mitterrand pour sa participation à
libération des otages de l'Airbus d'Air France à Marignane en
décembre 1994, explique aujourd'hui encore, comme il l'avait fait
devant la commission d'enquête, que Dianou lui est apparu dans un
nuage de fumée, brandissant une arme difficile à distinguer. Armé
d'un riotgun et après sommation, insiste-t-il, il aurait procédé à «un
simple tir de neutralisation». Une décharge de chevrotines dont l'une
touchera l'artère fémorale. «Pas un tir à tuer»,
plaidera Alain Picard dans «Ouvéa. Quelle vérité? »
Pustelnik dit «Puce» a la stature d'un héros. Il est unanimement apprécié.
«Quoi
qu'il ait pu faire, je lui conserve toute mon estime»,
déclare ainsi Alério Nannini, le lieutenant de l'EPIGN, qui a sans
doute été témoin de la scéne mais dit avoir refusé de répondre
aux questions des inspecteurs généraux, lesquels ont adopté sans
barguigner la version de l'intéressé. Celle
que j'ai recueillie - d'un autre gendarme présent sur les lieux -
est cependant bien différente. Dianou a consenti à se rendre après
que soient apparus en haut du cratère les premiers otages à avoir
emprunté la cheminée pour s'extraire de la cavité où ils
s'étaient réfugiés. L'un d'eux, Jean-Guy Pichegru, est rapidement
descendu retrouver ses camarades du GIGN embusqués à l'entrée de
la grotte, à guetter, l'arme à la main, la sortie des autres
occupants. Pichegru, l'homme qui avait utilisé une matraque
électrique lors des interrogatoires pratiqués à Gossanah et qui,
reconnu par un porteur de thé, avait failli être exécuté par
Hilaire Dianou et Wenceslas Lavelloi. C'est lui qui va «accueillir»
Alphonse lorsque celui-ci mettra le pied hors de la grotte. D'un coup
de poing en plein visage. Que «Puce», en spécialiste de la boxe
pieds-poings, prolongera d'un coup de pied circulaire, un «kick»
porté à l'arrière du genou, dans le creux poplité. Le leader
kanak est projeté au sol. C'est là qu'il recevra «un
coup de 12», selon l'expression en usage chez les
militaires, par référence au calibre de l'arme. «Le gars a
tiré en prononçant quelque chose comme : Tiens, de
la part des copains!», croit se souvenir un ancien du commando Hubert.
«C'est terminé, maintenant vous arrêtez!»
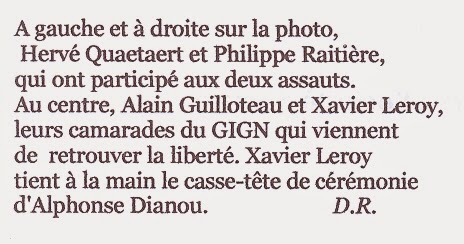 «Lorsque
Vidal a rejoint avec Legorjus les gens attroupés autour de Dianou,
l'un des officiers de Jayot, un type en tenue camouflée, aux allures
de gueule cassée, s'est planté au garde-à vous et lui a proposé
d'en finir : "Je n'aurai pas de problème de conscience,
mon général !"» C'est ce que relate l'officier qui m'a
rapporté un peu plus tôt le geste du chef du GIGN. Jacques Vidal,
qui dit ne pas se souvenir de cet épisode, aurait coupé court :
«C'est terminé, maintenant vous
arrêtez !» Mais Alphonse Dianou est déjà
un mort en sursis. Il succombera cinq heures plus tard sous les coups
d'un officier de gendarmerie mobile et de trois de ses hommes. J'y
reviendrai en détail dans le chapitre suivant.
«Lorsque
Vidal a rejoint avec Legorjus les gens attroupés autour de Dianou,
l'un des officiers de Jayot, un type en tenue camouflée, aux allures
de gueule cassée, s'est planté au garde-à vous et lui a proposé
d'en finir : "Je n'aurai pas de problème de conscience,
mon général !"» C'est ce que relate l'officier qui m'a
rapporté un peu plus tôt le geste du chef du GIGN. Jacques Vidal,
qui dit ne pas se souvenir de cet épisode, aurait coupé court :
«C'est terminé, maintenant vous
arrêtez !» Mais Alphonse Dianou est déjà
un mort en sursis. Il succombera cinq heures plus tard sous les coups
d'un officier de gendarmerie mobile et de trois de ses hommes. J'y
reviendrai en détail dans le chapitre suivant.
Deux médailles pour le meurtrier de Waïna
Tee
shirt et short bleu ciel, bermuda rouge-vert et ciré jaune : Patrick
Amossa Waïna arborait fièrement les couleurs du drapeau kanak. Une
forme de défi adolescent pour ce garçon de 19 ans venu, avec huit
de ses camarades, livrer le thé de la coutume et le repas de midi
des otages et de leurs gardiens. A sa sortie de la grotte, il est
allongé à plat ventre en attendant d'être pris en compte par les
gendarmes parachutistes de l'EPIGN. L'un d'eux lui demande de se
lever et, après l'avoir fouillé, le prend par le bras pour le
conduire quelques mètres plus loin, un peu plus haut, là où sont
déjà rassemblés Joseph Tangopi et plusieurs de ses camarades.
C'est le récit que ceux-ci vont faire aux journalistes qui viendront
les questionner quelques jours plus tard. C'est aussi ce que raconte
mon témoin, dont j'ai choisi de préserver l'anonymat.
L'arme
à la hanche, l'adjudant F..... ouvre le feu avec son riotgun, au risque d'atteindre
le gendarme qui côtoie sa cible mouvante. Une seule balle. Un tir en
biais, de bas en haut. Un projectile qui pénètre par le flanc
gauche, entre les 10ème et 11ème côtes, avant de ressortir par
l'épaule gauche. Patrick Amossa Waïna s'effondre sur lui-même,
comme une masse. L'adjudant prétextera qu'il tentait de s'enfuir.
Mais les témoins ne manquent pas qui peuvent assurer le contraire.
«Tout le monde était là, Vidal, Doucet, Jayot, le capitaine
Pattin...», affirme ce même témoin. Alério Nannini lui aussi
était présent. L'ex-lieutenant ne m'a pas révélé ce qu'il avait
vu ce jour-là : «Je ne vous raconterai rien si je n'ai pas
le feu vert de l'institution», c'est-à-dire de la Direction de
la gendarmerie, dont j'ai pu mesurer l'embarras persistant au sujet
de ces événements. «Oui, il y a eu des exactions, admet-il cependant. Nous aurions pu, nous
aurions dû intervenir physiquement, moi comme les autres. Mais nous ne l'avons
pas fait...»
Le
geste
de l'adjudant F..... ne sera jamais sanctionné. Mieux, quelques mois
seulement après les événements d'Ouvéa, il sera nommé à la tête du GPM,
le groupement des pelotons mobiles de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Moins de
deux ans plus tard, il se verra décerner la Médaille militaire. Avant de recevoir la Croix de la valeur militaire avec palme...
L'ancien
adjudant de l'escadron parachutiste exerce aujourd'hui ses talents en qualité de
détective privé. Un premier entretien s'était terminé de manière
plutôt brusque. Je l'ai néanmoins recontacté après que plusieurs
témoins l'aient nommément mis en cause, pour tenter de savoir, de
comprendre ce qui avait motivé son geste. Etait-ce le résultat de
la tension, de cette suite de nuits éprouvantes passées en
reconnaissance ? La démarche ne m'a valu qu'une froide promesse
de procès.
Une exécution à bout portant
Si
Patrick Amossa Waïna n'a pas eu droit à la plus petite mention de
la part des inspecteurs généraux, la fin de Lavelloi a été aussi vite
expédiée que celle du jeune porteur de thé. «Wenceslas Lavellli figure parmi les deux Mélanésins
trouvés morts à l'entrée immédiate de la grotte, l'autre étant
le preneur d'otages tué par les tireurs d'élite au début du
deuxième assaut. Tout laisse à penser en conséquence qu'il est
également mort au cours de l'action.»
C'est faux. «Lavelloi est sorti vivant après la fin des combats, affirme Thierry
Bidau, qui commandait l'élément du RIMaP chargé de
l'évacuation des blessés. J'avais disputé une partie de volley
avec lui quelques semaines plus tôt, alors que j'effectuais une tournée
sur l'île d'Ouvéa. Et il était facilement reconnaissable.» Tous les
récits recueillis auprès des Kanak rapportent, à quelques
variantes près, qu'un militaire est venu le chercher
parmi les prisonniers. Après qu'il se soit désigné - «Ah !
c'est toi qui joue les Rambo?!», allusion aux
cartouchières qu'il portait volontiers en sautoir – Lavelloi
aurait été emmené à l'écart, et tous disent avoir entendu peu
après un unique coup de feu. Les OPJ le découvriront devant la
grotte, tué d'une balle dans la tête, tirée à bout portant, non
loin d'Amossa Waïna, tous deux avec un FAMAS chargé déposé à portée de main.
Sur
ces deux morts-là, la justice va enquêter. Son cours arrêté, on
sait ce qu'il est arrivé au porteur de thé mais on ignore toujours qui a ordonné et qui a exécuté la «corvée de bois» infligée à
Wenceslas Lavelloi. On sait avec une quasi-certitude qu'il a été
emmené par un ou deux hommes du 11ème Choc.5 Et
il est hautement
improbable qu'un ou des militaires de cette unité aient agi de leur
propre initiative. Mais, sauf aveu tardif ou témoignage inespéré, on
cherchera sans doute encore longtemps qui a décidé de faire justice
pour la mort des deux soldats de la DGSE.
Prochain
article : «Il fallait qu'Alphonse Dianou meure !»
1. «Je
n'ai pas tiré un seul coup de feu de toute la matinée»,
reconnaît celui-ci. Qui n'est pas seul à
ne pas avoir pas tiré faute d'adversaire dans sa ligne de mire...
2.
L'explication ne vaut guère. D'une part, parce que les grenades
employées avant l'attaque du GIGN ont été prises sur les réserves dont
disposait le commando. Ensuite parce que les fusiliers-marins d'Hubert
n'étaient pas inclus dans le dispositif du deuxième assaut.
3. Deux
mois
avant de partir pour Ouvéa, Alain Pustelnik, qui possède un courage peu
commun, avait participé à l'arrestation de Philippe Bidart, le leader
du mouvement séparatiste basque Iparretarrak. Expert en arts
martiaux, spécialiste du coup de pied haut, il avait en juillet 1984,
déjà à Marignane, neutralisé à
mains nues un preneur d'otages allemand à bord d'un avion-cargo.
4. Sans
écusson et sans grade apparent, ils étaient néanmoins reconnaissables
par les hommes des autres unités en raison du foulard gris qu'ils
portaient à l'épaule.
Contre-enquête sur des morts suspectes
5. «Il fallait que Dianou meure...!»
«S’agissant des crimes commis pendant la guerre d’Algérie, la voie de la justice s’avère barrée (...)
Devons-nous
pour autant vouer au silence et à l’oubli les crimes de l’époque
?
L’exigence
de vérité demeure, rendue plus forte encore parce que justice ne
peut être faite.»
Robert
Badinter, dans Le Nouvel Observateur du 14 décembre 2000, à propos de l'amnistie des crimes commis en Algérie.
Cette
photo, communiquée à Paris-Match par
le N°2 de la gendarmerie, le major général Wautrin, sera au centre
de la polémique et suscitera de nombreuses questions de la part des
journalistes. On y voit Alphonse Dianou et huit autres preneurs
d'otages entourés de militaires dont, sur la gauche, les hommes du
GIGN.
Le
6 mai au matin, des gendarmes mobiles de l'escadron de Decize sortent
les corps des dix-neuf morts kanak du camion où ils ont passé la
nuit. D.R
C'est
à la lumière des projecteurs que le capitaine Stahl, médecin
détaché de la garnison militaire de Nouméa, a constaté la mort
d'Alphonse Dianou. Celui-ci repose alors sur le ventre, à même le
plancher du 4x4 dans lequel on l'a déposé sur une civière, moins
de trois-quarts d'heure plus tôt, dans la cour d'école de Saint-Joseph. Le
brancard est dressé contre le mur du hall d'accueil. Le corps est
encore tiède, «sans rigidité cadavérique». Dianou, touché
à l'arrière du genou, n'a plus de pansement. Son visage est «tuméfié
et ensanglanté» et il a le petit doigt de la main droite
écrasé, avec une phalange arrachée.
Sitôt la mort constatée, le
commandant de l'escadron de gendarmerie mobile de Decize, le capitaine B....., en avise
par radio le lieutenant-colonel Picard qui, à 18h10, lui avait donné
l'ordre de prendre en compte les prisonniers. L'information parviendra à Nouméa alors que Bernard Pons et
le général Vidal répondent aux questions des journalistes. Le
bilan définitif est désormais de dix-neuf tués. Plus de cinq
heures se sont écoulées depuis qu'Alphonse Dianou a été blessé
d'un tir de chevrotines.
Deux médecins lui ont apporté des soins
Deux médecins lui ont apporté des soins
Après la
reddition des preneurs d'otages, devant la grotte et sur le chemin de
crête, au milieu des arbres et des fougères arborescentes, il y avait
foule.
Parmi elle, trois médecins militaires : le docteur Jean-Michel
Churlaud, du Groupement
de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie nationale (qui
chapeaute le GIGN et l'EPIGN), son collègue Frédéric Thomas, affecté au
11ème Choc, et le médecin-anesthésiste Yann Gâtinois, attaché au
commando Hubert. Ce sont ces deux derniers qui, ensemble ou
séparément, ont apporté des soins à Alphonse Dianou.
Dans
une mise au point destinée à corriger l'information selon laquelle
on aurait posé un garrot à Dianou, ce qui aurait pu provoquer la
mort, le Dr Thomas a fait savoir qu'il lui
avait en réalité posé un pansement compressif, ainsi qu'une
perfusion : une poche de 500 ml de Plasmion destiné à compenser pour
partie la perte de sang consécutive à sa blessure.
«Ils ont shooté la perfusion!»
Si
l'on en croit les porteurs de thé, cette perfusion ne serait
cependant pas restée longtemps en place. Jean-Albert Nahiet et Waïna
Wéa sont sortis de la grotte parmi les derniers. Aux journalistes et
aux militants du Comité Pierre-Declercq, ils ont fait le même
récit. «On nous a emmenés à l'endroit où était Alphonse.
Quand nous sommes arrivés, il était assis et nous avons assisté à
la manière dont ils le maltraitaient : ils venaient lui pointer
les canons de fusil sur la tempe, foutaient des
coups de poing, des coups de bottes, raconte
Jean-Albert Nahiet. Ils ont même shooté la perfusion!»
«Nous sommes allés vers un
coin où j'ai vu les militaires transporter Alphonse sur une civière. Il tenait le sérum à la main. J'ai vu les militaires venir
taper, gifler, donner des coups de crosse. Celui
qui avait shooté le sérum portait un costume bleu-noir», témoigne Waïna Wéa.
Responsable
de la sécurité d'un grand hôtel parisien, Jean-Jacques Marlière a
assisté à la scène : «J'ai
vu, de loin, un militaire retirer la perfusion, puis il y a eu une
discussion animée et quelqu'un a remis la perf».
Une confirmation partielle. Qui laisse subsister le doute sur le
geste vengeur attribué à l'un de ses compagnons du GIGN. Car une
tenue bleu nuit, cela ressemble fort à la combinaison d'intervention
de cette unité d'élite.
«Plusieurs
étaient en tenue bleu-noir et d'autres en tenues
camouflées,» insiste Waïna Wéa. «C'est une
fable !» rétorquent, unanimes, ceux qui étaient
sur le terrain et ceux qui n'y étaient pas mais, tel Alain Picard,
n'en jurent pas moins avec certitude que c'était tout bonnement
impossible : les membres du commando avaient reçu l'ordre
formel de revêtir une tenue kaki. Une même couleur pour tous !
On peut aussi faire mentir les images...

Dans leurs ouvrages respectifs Jacques Vidal, Philippe Legorjus et Michel Lefèvre publient tous les trois une même photographie prise à 22h10 dans une salle de classe de l'école de Saint-Joseph, quelques minutes avant le départ du GIGN pour la marche d'approche en direction de la zone de combat. Le capitaine Legorjus y figure à la droite de Michel Lefèvre, en compagnie de douze de ses hommes. Tous ceux que l'on y voit ont le visage noirci et portent un treillis ou une combinaison de couleur unifiée, ici en vert et là en gris. Les Kanak auraient donc menti ?
 D'autres
images viennent cependant contredire la version des indignés. La
première (ci-contre), a été «capturée» dans le film réalisé pour France 2 par Elizabeth Drévillon et intitulé Grotte d'Ouvéa : autopsie d'un massacre. Cette
fois, les couleurs ne sont plus identiques, le kaki en paraît absent,
on compte un homme de plus et à gauche au premier rang se détache la
haute
silhouette du «Grand Michel Bernard» en tenue bleu nuit. Est-ce
un effet de l'éclairage ? Sur la photo prise en plein soleil à Saint-Joseph au
retour des combats et reproduite en tête de ce chapitre,
Michel Bernard, identifié comme l'un des gendarmes du GIGN qui
avaient mené des interrogatoires musclés à Gossanah, domine ses
camarades de la tête et des épaules. Et à y regarder de près, ce
n'est pas du kaki que l'on entrevoit.
D'autres
images viennent cependant contredire la version des indignés. La
première (ci-contre), a été «capturée» dans le film réalisé pour France 2 par Elizabeth Drévillon et intitulé Grotte d'Ouvéa : autopsie d'un massacre. Cette
fois, les couleurs ne sont plus identiques, le kaki en paraît absent,
on compte un homme de plus et à gauche au premier rang se détache la
haute
silhouette du «Grand Michel Bernard» en tenue bleu nuit. Est-ce
un effet de l'éclairage ? Sur la photo prise en plein soleil à Saint-Joseph au
retour des combats et reproduite en tête de ce chapitre,
Michel Bernard, identifié comme l'un des gendarmes du GIGN qui
avaient mené des interrogatoires musclés à Gossanah, domine ses
camarades de la tête et des épaules. Et à y regarder de près, ce
n'est pas du kaki que l'on entrevoit.
DR.
Enfin, sur un plan large qui montre les prisonniers kanak au milieu d'une foule accrue de militaires, publié dans son livre par le général de réserve Alain Picard, on aperçoit au centre, de face, un homme en combinaison bleue maculée de boue dont on ne voit pas la tête, mais dont un autre tirage (ci-contre) prouve qu'il s'agit bien de Michel Bernard2. Les Kanak n'ont pas rêvé. Mais une fois de plus, on aura tout tenté pour dévaluer leur parole.
«Des
gars voulaient empêcher
les toubibs de faire leur job»
Le
Dr Thomas, qui a passé dix-huit ans à la DGSE, m'a-t-il «servi»
un pieux mensonge histoire de protéger l'auteur du «shoot»
dénoncé par les porteurs de thé ? Probablement. «Lorsque
j'ai revu Dianou un peu plus tard, la perf était à moitié vide,
sans doute parce que le débit était mal réglé On a laissé la
tubulure et décidé d'en mettre une autre. J'étais avec Gâtinois
et nous l'avons posée ensemble, explique
le médecin du 11ème Choc, qui s'excuserait presque d'avoir laissé
traîner la poche de sang dans la nature.
«Lorsque nous avons voulu monter Dianou sur la crête,
on a constaté que la poche était vide. Totalement vide !»,
assure de son côté un gendarme de l'EPIGN...
Quoi
qu'il en soit, Dianou a bien reçu une
deuxième perfusion. «Pour qu'elle tienne solidement, nous
l'avons fixée avec du chatterton toilé pour
parachute, large de 10-12 centimètres, précise
Pierre Oléron, l'officier en second du commando Hubert venu aider
Yann Gâtinois, le médecin de l'unité. «Je me suis
retrouvé à côté de Dianou quand le docteur l'a pris en charge,
raconte pour sa part Thierry Bidau, le capitaine du RIMaP. Il
m'a demandé de lui faire une piqûre de morphine en m'expliquant
comment m'y prendre. Je ne sais plus si je lui ai planté l'aiguille
dans la fesse ou non, mais le toubib a posé la perf, après quoi on
l'a monté sur le côté droit.»
Si
les deux médecins militaires se sont conformés à leur déontologie,
cela ne n'est pas fait sans difficulté. Yann Gâtinois reconnaît
que des commandos avaient tenté de le dissuader
de soigner Dianou. Ce que confirme Alério Nannini, le lieutenant de
l'EPIGN : «Je me suis opposé à
certains des gars qui voulaient
empêcher les toubibs de faire leur job !»
Une
heure plus tard, Dianou est toujours là...
A
14h30, lorsque les OPJ parviennent sur les lieux, ils aperçoivent «un
groupe de dix-huit prisonniers, gardé par des membres du commando».
«A proximité de ce groupe, un Mélanésien preneur
d'otages, Dianou Alphonse, est allongé sur un brancard, écrit
l'adjudant Da Silva. Cette personne est blessée à la
cuisse gauche, placée sous perfusion; un médecin est à ses côtés.»
Selon le commandant de la BR de Nouméa, c'est seulement après ce
constat que «les membres du dispositif médical prennent Dianou
en charge pour l'évacuer sur l'aéroport d'Ouloup où est implanté
un hôpital de campagne»...
Pourquoi
Dianou n'a-t-il pas été évacué plus tôt ? Pourquoi l'a-t-on
dirigé sur Saint-Joseph et non pas sur Ouloup ? L'hémorragie
était stoppée, il était perfusé et sa vie n'était pas en danger, persistent à dire les médecins militaires. «D'après le toubib,
il n'y avait pas d'urgence et j'ai décidé de ne pas l'évacuer tout
de suite. On ignorait si tous les preneurs d'otages s'étaient rendus et sa présence
pouvait encore être utile», se justifie Thierry Bidau. Ce
n'est donc qu'après l'arrivée des OPJ que le chef kanak sera enfin
brancardé jusqu'à la DZ par son frère Hilaire et trois de leurs
compagnons.
Une malencontreuse erreur d'aiguillage ?
Aujourd'hui
encore, Eric Polaillon assume : non, il n'a pas agi sur ordre.
Commandant de l'école de gendarmerie de Châteaulin depuis le mois
d'août dernier, le colonel Polaillon, alors jeune capitaine à
l'EPIGN, assurait le contrôle de la zone de posé et les évacuations
par hélico. Selon le rapport des inspecteurs généraux, il n'aurait
pas respecté «les procédures prévues pour les blessés» et «orienté
Dianou sur le point de regroupement des prisonniers à Saint-Joseph,
et non sur Ouloup (...).
Pour étayer sa décision, il avait recueilli, selon lui, l'avis
du médecin du GIGN.» Eric Polaillon confirme : le Dr Churlaud
lui ayant garanti que la situation du blessé «ne présentait pas
un caractère d'urgence», il aurait pris sur lui de le diriger
sur Saint-Joseph.3 Après «l'incident» de la première perfusion,
après la longue attente imposée à Dianou sur le lieu des combats,
cette prétendue «erreur d'aiguillage» sera lourde de
conséquences.
Il
est 15 heures lorsque le Puma qui transporte Dianou
s'immobilise à proximité de l'église de Saint-Joseph. Les huit
preneurs d'otages sortis de la grotte après lui sont dans le même
appareil. Trois semaines plus tard, incarcérés dans différentes
prisons de la région parisienne, ils
communiqueront à leurs avocats des témoignages qui seront publiés
dans Le Nouvel Observateur du
27 mai. Ils
y affirment que
leur chef a été jeté de l'hélicoptère.
«J'ai
entendu avec stupeur toutes sortes d'horreurs sur ce qui lui était
advenu durant son transfert, la plus abjecte de ces allégations
étant qu'il aurait été jeté à l'extérieur avant le posé de
l'appareil...
Comment aurait-on pu commettre un acte aussi ignoble !»,
s'indigne «le Gros Michel», le chef de groupe du GIGN qui, avec quelques-uns de
ses hommes, accompagnait les prisonniers.
«Alphonse a été balancé de l'hélico!»
«Alphonse a été balancé de l'hélico!»
Ce
ne sont pourtant pas les Kanak qui sont à l'origine de cette
abjection. Non. Ce sont des gendarmes mobiles de l'escadron 1/20 de
Decize, celui qui a eu pour mission de conduire les prisonniers à
Ouloup. Après la sortie du film de Mathieu Kassovitz, la version
accablante qui fait bondir Michel Lefèvre a beaucoup circulé sur les
réseaux sociaux - des forums de gendarmes à celui du Figaro
- à
l'initiative du radio de l'escadron, Jean-François Imbert alias
Paulao, détaché auprès du lieutenant-colonel Picard auquel il
servira de chauffeur durant une partie des opérations. Son
chef d'escadron, Alain B....., accorde tout son crédit à
cette version et me l'a ressortie avec insistance lors de nos
entretiens. Un de ses camarades, enfin, m'a affirmé les yeux dans
les yeux: «Dianou
a été balancé de l'hélico alors que celui-ci se trouvait à
hauteur du clocher de Saint-Joseph !» Qui
croire,
les gendarmes mobiles ou bien Michel Lefèvre, qui concède
que la civière a pu se renverser après que l'un de ses
porteurs ait trébuché ? Ou encore, pourquoi pas, les Kanak, selon
lesquels l'hélico était posé lorsque Dianou a été projeté hors de
l'appareil ?...
A
Saint-Joseph, il y avait du monde à l'arrivée des preneurs
d'otages. Et Henri Knorst, un gendarme parachutiste, était aux
premières loges : lors de l'arrivée de Dianou, il faisait
fonction d'orienteur-baliseur (il guidait l'appareil et l'aidait à
se poser). «Les trois roues du Puma
étaient au sol, assure-t-il. Le gars du GIGN qui avait «tiré»
Dianou à la grotte (Alain Pustelnik) 4 a sauté de l'hélico, l'a attrapé par le col,
l'a sorti d'une seule main et l'a jeté à terre.» «Il y
avait près de moi un pilote de Puma
qui a filmé la scène avec une caméra vidéo», ajoute Henri
Knorst. «C'est exact. Un lieutenant de l'armée de l'Air a bien
filmé l'arrivée de Dianou, confirme Philippe Mauviot, qui
commandait le détachement d'hélicos.
Mais où est passée la deuxième perfusion ?
Mais où est passée la deuxième perfusion ?
Les
inspecteurs généraux opteront pour une version
soft :
«Dianou,
peut-être descendu sans ménagement de l'hélicoptère,
a été placé dès son arrivée à côté de l'église de
Saint-Joseph, dans le groupe des prisonniers, sur un brancard.»
«Comme
en témoignent les photographies prises par l'officier des
renseignements du PC, écrivent-ils,
le pansement était bien en place et le visage de Dianou, bien que
crispé, ne
portait aucune trace de coups».
Je
n'ai pas vu ces photos-là. Mais si la photographie qui a fait la
double page centrale de Paris-Match ne
permet pas de distinguer le visage de l'intéressé, celles
d'Alain Picard, d'excellente qualité, prouvent hélas le contraire.
Un agrandissement de 200% sur écran d'ordinateur de l'image ci-dessous
montre que Dianou souffre d'une blessure à l'arcade sourcilière gauche
et que ses
paupières gauches sont tuméfiées. Comme les médecins légistes le
constateront le lendemain.
Dianou
sur sa civière. Autour du cou, une étiquette mentionne ses
blessures. Fixé à son bras droit, on distingue le mince tuyau qui
le reliait à la perfusion. Il a un pansement ensanglanté à la
cuisse gauche et un autre au genou. Plus ce qui ressemble à une
genouillère (?), descendue au-dessus de la cheville.
Ce
n'est pas tout. Le capitaine Polaillon et plusieurs autres témoins ont
observé que lorsque le blessé a été hissé à bord du Puma,
il tenait à la main la poche de sang de remplacement. Or, sur les
clichés réalisés à Saint-Joseph, cette poche a disparu. Ne
subsiste que le mince tuyau qui la reliait au patient. Que s'est-il
donc passé durant ces quelques minutes qui ont suffi à transférer
Dianou de la DZ à Saint-Joseph ? «Après
que tout le monde ait quitté l'hélico, je suis monté dans la
carlingue pour récupérer le matériel qui traînait sur le
plancher,
confie Henri Knorst. C'est
là que j'ai retrouvé la perf'...»
Une curiosité malsaine
Les inspecteur
généraux ont donc menti. Jacques Vidal également. Après avoir rédigé
son compte-rendu d'opération, il accueille Bernard Pons, le général
Norlain et le général Jérôme venus en hélico afin de préparer
la conférence de presse que le ministre doit tenir à 18 heures à
Nouméa. «Vers
16 heures, en sortant de mon PC avec le ministre, j'aperçois
l'attroupement des militaires et gendarmes autour des prisonniers
derrière l'église, à une cinquantaine de mètres de nous, écrit-il
dans son livre-témoignage.
Sans savoir que Dianou blessé est parmi eux (je pense alors qu'il a
été évacué à Ouloup) mais jugeant cette curiosité malsaine, je
demande à mon chef d'état-major, le lieutenant-colonel Dubut, de
faire mettre les prisonniers à l'écart dans l'école et d'éloigner
tous les militaires qui n'ont rien à faire sur les lieux.»
L'intention
est louable. Mais le général, qui ne peut ignorer sa présence,5 vient de signer sans le savoir l'arrêt
de mort d'Alphonse Dianou.
---------------------------------------------------------------------
Les
neuf Kanak étendus devant l'église vont alors être conduits dans
la cour de l'école transformée en casernement. «En
ce lieu, les prisonniers, dont le blessé, ont été pris en compte
par un commandant d'escadron de gendarmerie mobile qui avait reçu
l'ordre de les acheminer par voie routière sur Ouloup, en raison de
l'état de santé de Dianou»,
écrivent
les généraux Berthier et Rouchaud. Explication fallacieuse : pourquoi
faire prendre à un convoi une route réputée peu sûre alors
que, selon plusieurs témoins, deux Puma sont
là, à quelques pas, qui permettraient d'économiser un temps
précieux6 ? «L'attente
de Dianou à Saint-Joseph peut être évaluée à trente minutes»,
indique leur rapport d'enquête. C'est faux. Débarqués à 15
heures par hélico, ce n'est qu'à 18 h 10 que les prisonniers seront
acheminés vers Ouloup.
Après
avoir épinglé le chef d'escadron qui «se
serait laissé aller à frapper violemment le visage des
prisonniers, dont celui de Dianou (…),
les officiers enquêteurs avancent que ce dernier «a été
l'objet de sévices graves entre le moment de son stationnement à
Saint-Joseph et celui de son arrivée à Ouloup» et
qu'il «est mort au cours de son transfèrement». Ils se trompent.
Achevé sous les yeux de gendarmes
Pierre
Oléron, l'officier en second du commando Hubert, entendu par les
deux généraux dans son bureau de Saint-Mandrier où est basée
l'unité, se trouvait dans la cour de l'école. «On était assis
en train de nettoyer nos armes, dit-il. J'ai vu des
gens qui n'étaient pas des intervenants donner des coups de pied aux
gars au sol.» «Le capitaine B.... avait récupéré un chien, une
sorte de Malinois, qu'il excitait pour qu'il attaque les
prisonniers», se
souvient Henri Knorst.
Dianou
sera transporté en premier et placé dans un 4X4 bâche relevée
dont on a retiré le banc central. «A ce moment-là il
était déjà mal en point, raconte Henri Knorst. B....
était à l'intérieur du camion. Une fois Dianou allongé sur le
plancher, il lui est monté dessus et a ordonné à ses gens de faire
la même chose. Quelqu'un a regimbé et là, il s'est montré cassant et menaçant avec ses gars. «B.....
appuyait sur la cage thoracique», précise un de ses
camarades de l'EPIGN témoin de la même scène.
Venus
récupérer leurs affaires dans la salle d'école qui leur avait
servi de dortoir, plusieurs autres membres de l'escadron parachutiste
m'ont rapporté les violences auxquelles ils avaient assisté. Les
anciens de l'escadron de Decize se sont montrés plus réticents. La
plupart de ceux que j'ai pu questionner continuent d'éprouver une
sympathie manifeste pour celui qui fut leur commandant. Et ceux qui
acceptent de témoigner ne le font que sous couvert de l'anonymat.
«Dianou hurlait de douleur!»
«C'est
avant notre départ de Saint-Joseph que ça s'est passé, dit
l'un. B.... nous regardait, tout fier de lui. Certains
d'entre nous étions dégoûtés.» «Pendant que ça se
passait, il y avait dix-douze gars à poil qui se décrassaient au jet
au fond de la cour et d'autres qui étaient aux fenêtres à
crier : « Assassin !
Assassin !», rapporte un autre. Dans le 4x4, B..... était avec
trois jeunes gendarmes de l'escadron. Un sous-officier a rappelé
l'un d'eux, qui faisait partie de son peloton. Mais le capitaine a
répliqué : Il reste
là ! » «Dianou
hurlait de douleur.7
On a entendu un dernier cri et puis plus rien,
relate encore un gradé de l'escadron. Et lorsque nous avons
quitté Saint-Joseph, j'ai aperçu un chien errant avec un pansement
ensanglanté dans la gueule...»
Le chef d'escadron Claude Damoy, qui accueillera 40 minutes
plus tard le convoi à Ouloup, résume d'une phrase désabusée sinon
l'intention du moins le sentiment général de tous ceux qui ont
permis cela : «Il fallait
que Dianou meure pour mettre fin à l'action....» Un homme s'est chargé de la besogne. Et cela n'a pas entravé sa carrière. Après un passage par le Bureau des Enquêtes et Contrôles (les «bœuf-carottes»
de la gendarmerie), l'ex-capitaine B... a quitté l'institution avec le
rang de colonel. Fait chevalier de la Légion d'Honneur par Jacques
Chirac le 6 juillet 2000 sur proposition d'Alain Richard, ministre de la
Défense dans le gouvernement de Lionel Jospin, il a été jusqu'en 2011
délégué départemental du Médiateur de la République et exerce
aujourd'hui cette même fonction auprès du Défenseur des Droits...
Prochain article : L'homme qui tua Alphonse Dianou
1. «Je comprends que certains aient été choqués de voir ainsi les morts transportés en sling (un filet suspendu à un câble sous l'hélico), explique l'ex-capitaine Thierry Bidau.
Mais la nuit allait tomber, il fallait faire vite et nous ne disposions
que deux ou trois brancards. J'avais demandé au pilote d'aller les
déposer sur la DZ pour qu'ils soient chargés à l'intérieur d'un autre Puma
et de revenir prendre les corps restants. Or, il est allé droit sur
Ouloup. L'autre partie des corps a été emmenée dans un hélico.»
2.
A gauche sur la photo, un autre supergendarme, Philippe Raitière dit
l'Ecureuil, apparaît en combinaison bleu nuit. Mais celle-ci est propre
et sa crinière rousse est impeccable alors que d'autres photos prises
sur le terrain le montrent le cheveu ébouriffé et en treillis kaki. Il a
visiblement pris une douche avant de se changer.
3. Ceci semble peu crédible. Mais je n'ai pu obtenir confirmation des informations recueillies par Le Monde selon lesquelles Dianou aurait été dirigé sur Saint-Joseph sur ordre exprès du général Vidal.
4. Dans leur livre Mourir à Ouvéa,
Edwy Plénel et Alain Rollat avancent qu'en tirant sur Dianou, Alain
Pustelnik aurait voulu venger son ami Eric Moulié (lui aussi membre du
GIGN mais que Philippe Legorjus a refusé d'emmener à Ouvéa) dont le père
a succombé le lendemain de l'attaque de la brigade de Fayaoué. Tué par
Alphonse Dianou selon certains gendarmes mobiles pris en otages. Par
son frère Hilaire selon plusieurs autres.
5. Sans doute n'a-t-il pas assisté à l'arrivée de Dianou. Mais un membre de son état-major est présent sur la photo de Paris-Match
et Philippe Legorjus comme Patrick Destremau, qui vont embarquer pour
Nouméa dans le même hélico, ont tous deux vu le blessé un peu plus tôt.
Difficile de croire que tous aient omis de signaler sa présence.
D'autant que le capitaine du GIGN figure sur la photo publiée par le
général et sur laquelle on voit celui-ci, geste à l'appui, donner
l'ordre de déplacer les prisonniers...
6 .«Je m’inscris totalement en faux :
vous avez des témoins, je veux bien vous croire, mais moi je n’ai pas
vu d'hélicos à Saint-Joseph, du moins lorsque j’avais la responsabilité
des prisonniers, réagit le général Picard. Pourquoi voulez-vous, dit-il, que je n’utilise pas un tel moyen si cela avait été possible ? »
7. Dianou
a reçu une injection de 15mg de morphine aux alentours de 13h30. Or la
durée d'action de la morphine n'excède pas quatre heures. Cela signifie
qu'il a souffert. De sa blessure et sous les coups reçus à Saint-Joseph
avant son départ à 18h10.
---------------------------------------------------------------------
Ci-dessous: le compte-rendu d'examen du corps d'Alphonse Dianou.