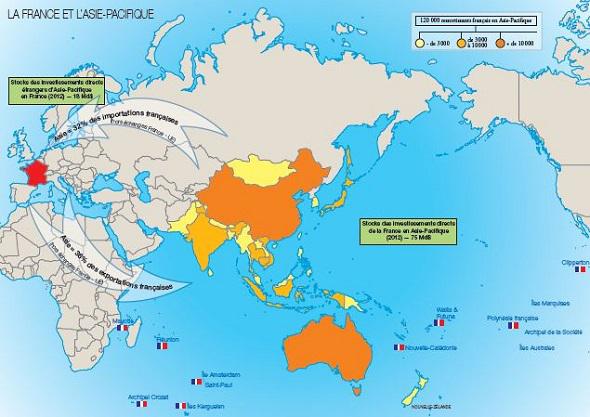La France est le seul pays européen à maintenir une capacité
militaire permanente dans la zone Asie-Pacifique, avec les Forces Armées
de Polynésie Française (FAPF) de celles de Nouvelle-Calédonie (FANC).
Et cela est un atout dans la mesure où cette région est stratégique à
plus d’un titre. « Notre prospérité est liée à celle de l’Asie, toute
crise dans cette zone affecterait nos intérêts », affirmait, en avril,
Philippe Errera, le directeur aux affaires stratégiques (DAS).
Le dernier Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale
(LBDSN) a également évoqué importance en soulignant que la zone
Asie-Pacifique « joue un rôle déterminant dans la mondialisation » en
étant « le principal foyer de croissance du monde » mais constitue aussi
« l’une des régions où les risques de tensions et de conflits sont les
plus élevés ».
Mais cette région est vaste… Aussi, un rapport du Sénat
s’est plus particulièrement intéressé à l’Asie du Sud-Est, dont les 10
États qui la composent constituent la 4e puissance économique mondiale,
avec 110 milliards d’investissements étrangers par an et des besoins
importants. « Ils s’affirment, de plus en plus, comme des acteurs
globaux sur la scène internationale », explique le document.
« Nous avons désormais en Asie du Sud-Est autant de ressortissants
qu’en Afrique de l’Ouest, autant d’intérêts économiques qu’en Chine, et
en plus nous partageons une vision commune des relations
internationales », a fait valoir le sénateur Jean-Claude Peyronnet
(Haute-Vienne), co-auteur du rapport. « Les opportunités sont immenses
pour nos entreprises : défense, aéronautique, automobile,
infrastructures, énergie, agro-alimentaire, santé, économie maritime… »,
a surenchéri son collègue Jean-Claude Requier (Lot).
En outre, le document relève qu’ »avec une spectaculaire inversion – à
son avantage – de la relation de dépendance économique avec l’Occident,
l’Asie du Sud-Est émergente est le creuset des évolutions géopolitiques
actuelles, et notamment de la remise en cause des principes
« occidentaux » du droit international (liberté de circulation en mer,
notamment…) ».
Seulement, cette partie du monde a été négligée par la France depuis
une vingtaine d’années. Il y a 15 ans, l’on comptait ainsi 450
entreprises françaises implantées en Indonésie contre seulement 150
actuellement, alors que ce pays connaît une croissance économique
rapide. « sommes depuis 20 ans des bailleurs d’aide publique au
développement dans ces pays en rattrapage accéléré : où sont les
résultats sur le plan économique? », s’est demandé Christian Cambon,
co-rapporteur.
Aussi, étant donné l’importance de l’Asie du Sud-Est, le rapport
estime que la France doit jouer aux mieux ses atouts afin qu’elle
saisisse les opportunités offertes par cette région. Pour rappel, Paris a
des liens profonds avec la Malaisie et des partenariats stratégique
avec Singapour, l’Indonésie et le Vietnam. Mais cela n’est évidemment
pas suffisant.
« Les ‘géants’ de l’Asie (Inde, Chine, Japon) ne doivent pas nous
cacher l’Asie du Sud-Est », estime le rapport des sénateurs, qui
regrette que la « France peine à définir ses objectifs, à maintenir ses
priorités dans la durée, et à redéployer ses moyens, notamment
diplomatiques, vers cette zone émergente ».
Aussi, les sénateurs ont défini trois priorités : définir une
stratégie à haut niveau en s’appuyant sur 3 États pivots (Malaisie,
Indonésie, Singapour) et sur l’ASEAN (Association des nations de l’Asie
du Sud-Est), « faire de la diplomatie économique le fer de lance » du
pivot, notamment autour des « besoins de ‘l’économie verte’ et de
‘l’économie bleue’ » avec l’objectif d’optimiser les retombées
économiques de 20 ans d’aide au développement et, enfin, de « s’engager
pour la sécurité » en élargissant la coopération militaire
(contre-terrorisme, échanges d’officiers, exercices, escales…) et en y
maintenant des « moyens crédibles ».
Pour cela, le rapport a établi une feuille de route à court et moyen
terme. Ainsi, au cours des 6 prochains moins, il suffirait d’adhérer à
l’organise de lutte contre la pirateurie ReCAAP « en réglant de façon
pragmatique la question de la traduction en langue française » et de
« lancer un audit global des différents programmes de personnalités
d’avenir pour l’Asie du Sud Est ».
Le programme à un an est plus étoffé et met l’accent sur la
diplomatie et le rétablissement de l’influence française. Pour
commencer, il propose de faire du « rattrapage de nos positions
économiques en Indonésie et au Vietnam » la « priorité numéro 1″ ainsi
que d’avoir un rythme soutenu de visites officielles dans la région
(déplacement du ministre de la Défense en Malaise, tournée
présidentielle).
L’accent est aussi mis sur les questions de sécurité, avec la
pérennisation de la présence française au au dialogue Shangri-La de
Singapour, la signature du protocole sur la création d’une zone exempte
d’armes nucléaires en Asie du sud-est (traité SEANWFZ), la proposition à
la Kuala Lumpur d’un partenariat stratégique et le renforcement de la
coopération de défense « en visant un pourcentage de 15% à 20% dévolus à
l’Asie du Sud-Est » et en répondant favorable aux demandes de formation
des armée locales.
Enfin, d’ici deux ans, la feuille de route des sénateurs préconise
d’avoir un diplomate à plein temps auprès de l’ASEAN, de rééquilibrer
les moyens diplomatiques vers l’Asie, et plus particulièrement
l’Indonésie, d’assurer une « une présence de la Marine Nationale
régulière et visible en Asie du Sud-Est, en privilégiant notamment,
outre les missions des Frégates de surveillance, le déploiement de
bâtiments modernes, puissants et visibles comme les Bâtiments de
projection et de commandement (BPC), voire les sous-marin nucléaire
d’attaque » (ndlr, un SNA n’est pas ce qui se fait de mieux en matière
de visibilité) et d’appuyer « en tant que membre du Conseil de Sécurité,
le rôle global joué sur la scène internationale par la Malaisie,
Singapour et l’Indonésie (négociations climat, zone sans armes
nucléaires…).